> Accueil
-

Pour tout bagage
-

Das Feuer
-

Lettre à B.
-

Hével
-

Dernier été et autres nouvelles
-

Une plaie ouverte
-

La saga des brouillards
-

Dernier été
-

Petit éloge des coins de rue
-

L’homme à la carabine
-

Tranchecaille
-

L’affaire Jules Bathias
-

Soleil noir
-

Le Voyage de Phil
-

Boulevard des Branques
-

Vague à lame
-

Belleville-Barcelone
-

Ciao Pékin
-

Les Brouillards de la Butte
-

Des méduses plein la tête
-

Terminus nuit
-

Tiuraï
-

Bandits et Brigands
-

Paris noir
-

Banlieues parisiennes, Noir
Boutique
Contact
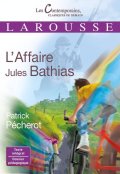
"Raconter, c’est transmettre"
La recherche généalogique qui ouvre l’affaire Jules Bathias se révèle prétexte à une enquête d’un autre type. La phrase de Mac Orlan que vous citez souvent à propos du polar, « quand je regarde un arbre, je vois un pendu ? », vaut aussi pour les arbres de famille ?
Patrick Pécherot La généalogie n’est pas très éloignée de l’enquête policière avec une différence de taille. Celui qui s’y livre enquête finalement sur lui-même. Ce n’est pas sans risque. Trouver un cadavre dans le placard en fait partie. Mais les transformations de la structure familiale, la mobilité géographique, les mouvements de populations, la vitesse, aussi, font qu’on éprouve la nécessité de se poser et de regarder en arrière. Cette recherche d’identité concerne aussi bien des individus que des groupes entiers, à travers la recherche mémorielle. Nous portons tous une part de ceux qui nous ont précédés. Pas seulement à travers l’hérédité. Leur histoire a contribué à forger cette Histoire, avec son grand H, dont nous sommes aussi les produits. Alors, quand on est un enfant solitaire, comme Valentin, le héros du livre, il arrive que l’enquête se change en quête. Et vous conduise à vous colleter avec les fantômes qui hantent cet envers du décor cher au polar et à Mac Orlan.
Philémon, le héros du Voyage de Phil était un enfant malade. Valentin, celui de L’affaire Jules Bathias est timide, presque introverti. Vous affectionnez les anti-héros ?
P.P. Pas besoin d’avoir la stature du baroudeur en herbe pour se lancer à l’aventure. Elle est à la portée de main. Celle qu’on mène de sa chambre peut se révéler riche en rebondissements. Le Voyage de Phil jouait avec les canons du road movie. L’affaire Jules Bathias visite ceux du voyage intérieur. Mais pour Valentin, comme pour Philémon c’est l’imaginaire qui ouvrira les portes. Pas la taille de leurs muscles ni quoi que ce soit du genre. J’en ai un peu assez qu’on transforme les gamins en petits adultes, c’est comme si on en faisait des singes savants qu’on exhibe dans les cirques. Ils méritent le respect pour ce qu’ils sont, pas pour ce à quoi on cherche à les faire ressembler.
La première guerre mondiale n’est pas un thème classique à la littérature jeunesse…
P.P. La guerre de 14 paraît presque aussi lointaine, que celle de cent ans. Pourtant, c’était hier. Le temps est une notion toute relative. J’ai cinquante trois ans. Rien d’extraordinaire. Mais penser que cela me fait naître seulement trente cinq ans après l’armistice de 1918, me donne le sentiment d’être beaucoup plus vieux. C’est en fait la guerre qui est plus proche. Pour ma génération, celle des quinquas, elle était encore très présente. Les grands parents en parlaient. Quand j’avais une dizaine d’année, beaucoup d’anciens combattants n’avaient guère plus de soixante cinq ou soixante dix ans. Mon grand-père, mes grands oncles l’ont faite… Les familles étaient marquées par des deuils. On vendait encore des billets de loteries pour les « gueules cassées »… Cette proximité n’est pas étrangère à l’engouement qu’elle suscite aujourd’hui à travers les documents, la littérature, le cinéma ou la BD. Pourquoi un jeune lecteur y serait-il insensible ? Si mon Jules Bathias lui donne envie d’aller plus loin, qu’il fonce ! Il ne manquera pas de matériaux. A commencer par les bouquins que Valentin emprunte à la bibliothèque.
Avec le personnage de Fernande, comme hier avec celui d’Anselme, vous abordez à nouveau le thème de la transmission. Un souci récurrent ?
P.P. Recevoir ce que d’autres vous transmettent est inhérent à la construction de soi même. Je suis très sensible à l’aspect « rapport à l’ancien », celui qui possède la mémoire. Et qui, la possédant, se souvient aussi de ce qu’il a été, de ses erreurs. Qu’on le veuille ou non, quand on raconte, on transmet. Alors, autant ne pas transmettre n’importe quoi.
Propos recueillis par Scup pour pecherot.com
"Le monde est bancale, donc réparable..."

« Quand on est seul, réparer le monde est illusoire »
A relire votre trilogie consacrée au Paris populaire de l’entre-deux guerres, comme les deux romans qui ont pour héros le journaliste Thomas Meckert, on se dit que ce monde est pourri...
Patrick Pécherot. Non ! Le monde n’est pas pourri, il est bancal. Donc réparable.
Mais « les petits, les sans grades » sont anéantis bien souvent. Et c’est d’eux que vous parlez dans tous vos livres, avec qui vos héros comme vous-même êtes en empathie, comme dans Soleil noir, votre tout dernier roman paru en Série noire...
P.P. Les vrais acteurs de l’Histoire, les petites gens, ont souvent servi de chair à canon. Individuellement ils ont peu de prise sur l’Histoire. Elle les broie. La vie elle même vous esquinte, on s’amoindrit, on vieillit, on a des cicatrices, mais ces cicatrices sont aussi la preuve qu’on est vivant, qu’on réagit. De la même façon, ces petites gens, qui ont des vies difficiles connaissent de grandes joies, de grands espoirs et de grands engagements. C’est ce que j’essaie de refléter dans mes romans. Je n’ai pas du tout l’impression qu’ils soient si sombres. J’y mets pas mal de la gouaille, elle permet de rendre moins dur le noir goudron. Au « noir c’est noir » je préfère le gris de la mélancolie. Au fil du temps mes illusions se sont émoussées mais je ne suis ni désabusé ni désespéré. Je pratique plutôt ce que j’appelle la désabusion, une forme de recul, de distance.
Votre premier roman, Tiuraï, se déroule à Tahiti quand la France y menait des essais nucléaires… Thomas Meckert est impuissant à aider qui que ce soit et le roman s’achève sur un véritable anéantissement de tous ceux qui ont tenté de révéler ce qui se passe...
P.P. A l’époque où j’ai écrit Tiuraï il n’y avait pas d’autre façon de parler de ce qui se passait à Tahiti, tout y était verrouillé. Et puis mes héros sont des solitaires. Quand on est seul, réparer le monde est illusoire, on peut juste mettre un peu de baume sur la petite histoire. Pour autant, les choses peuvent changer. La preuve : les essais nucléaires ont été arrêtés.
Et quand vous écrivez pour les enfants ?
P.P. Quand j’écris pour les adultes je ne me demande pas pour qui j’écris. Quand j’écris pour les enfants, si. Je ne développe pas autant les digressions, les jeux d’écriture… Je bride un peu mon goût de la gouaille. Je ne renonce pas à l’humour, mais il est moins mordant que dans mes romans pour adultes.
Je m’autocensure aussi en choisissant des références culturelles que des jeunes lecteurs peuvent partager. Dans Le Voyage de Phil, c’est mon amour du roman d’aventures, d’Arsène Lupin et surtout de son modèle Marius Jacob que j’essaie de faire passer. Quand on veut transmettre on est obligé de se poser la question du « à qui ? » et du « comment ? ». Le polar dont je me réclame plonge dans le roman social, mais quand j’en écris pour les enfants j’équilibre de façon à ne pas saper la part de rêve si nécessaire. Le premier roman, lu dans mon enfance, qui ait compté pour moi c’est Le Club des cinq et les Gitans. J’étais tombé amoureux de la petite gitane. Je crois que la jeune manouche amie de Phil en est une résurgence. Dans le roman d’Enid Blyton, il était aussi question d’injustice. Comme quoi, bien des choses peuvent naître d’un simple petit bouquin de la Bibliothèque Rose.

Si on cache la cruauté du monde aux enfants ou si on leur fait croire qu’eux pourront tout changer alors que nous avons échoué on prend le risque de leur mentir, non ?
P.P. Mais on n’a pas échoué ! Les changements s’opèrent dans la durée. Le mensonge serait de faire croire aux baguettes magiques. Les enfants d’aujourd’hui vivent infiniment mieux que ceux de la première moitié du XXème siècle. N’est-ce pas la preuve qu’on peut transformer les choses ? Dans mes deux romans pour jeunes lecteurs, mes héros changent leur rapport au monde et leur rapport à eux-mêmes. Phil, malade, trouve la force de vivre. Valentin, le timide en bute au harcèlement, affrontera ses bourreaux et fera tomber le mensonge qui pesait sur eux tous. C’est aussi cela changer la vie, réparer. Je crois en la force des doux.
Pour quels enfants écrivez vous ?
P.P. Les enfants d’aujourd’hui, dont la vie diffère de celle que je menais. Ils sont collés au monde, avec en rouleau compresseur la télé du matin et les médias de l’immédiateté qui les privent du recul nécessaire. Quand on s’adresse à eux on est sur le fil : on ne peut leur cacher la dureté du monde, il ne s’agit pas de l’embellir, mais on ne peut pas non plus en donner une vision no future car ce serait dire qu’ils n’y ont pas leur place. Quand j’étais ado j’écoutais Léo Ferré en boucle. Dans les années 1970 il est devenu de plus en plus nihiliste, il chantait devant un public de plus en plus jeune « Il n’y a plus rien ». Son pianiste Paul Castanier n’a plus voulu l’accompagner à ce moment là, il pensait qu’on ne peut pas dire à des ados « il n’y a plus rien ». Je le pense aussi. On peut dire que la vie est difficile, oui, mais cela n’empêche pas de prendre son destin en main. Le problème du message ne concerne pas seulement sa nature, mais aussi celui à qui il s’adresse.
Dans Le voyage de Phil, comme dans L’affaire Jules Bathias, vos jeunes héros rencontrent des adultes qui vont les soutenir. Phil, malade, est soutenu par ce bouquiniste qui lui offre l’aventure en lui proposant de partir sur les traces de Marius Jacob, l’aventurier anar au grand cœur... Il lui donne aussi de la tendresse et incarne une figure paternelle idéale. Tendresse et part de rêve préservée c’est cela qui va donner à Phil la force de vivre ?
P.P. Oui. Phil est très malade, je ne dis pas qu’il va guérir mais ce qui compte c’est qu’à la fin du roman il vive, qu’il ait cette force de se projeter dans l’avenir. Avec le polar on peut transmettre des valeurs, des visions du monde, une morale, à condition d’éviter la leçon de morale. Elles sont généralement insupportables.
Cette vision d’un adulte qui accompagne, qui transmet mais n’impose pas son credo, vous la mettez aussi en scène dans L’Affaire Jules Bathias à travers le personnage de Fernande…
P.P. Fernande sait. Mais elle ne dit pas tout ce qu’elle sait à Valentin. Elle l’encourage, c’est lui qui fera le travail, qui cherchera qui était vraiment son ancêtre et qui découvrira comment il est mort. Ce n’est pas une bourreuse de crâne, Fernande, c’est un catalyseur.
A travers le polar et sa dimension de roman social ce qui vous intéresse c’est la transmission ?
P.P. Je crois bien que dans mes romans il n’ y a que cela en fait.
Transmission de l’histoire contemporaine vue du côté des petites gens, mais aussi transmission de votre goût de la littérature. Dans tous vos romans vous faites la part belle aux auteurs que vous aimez et l’intrigue du Voyage de Phil repose entièrement sur cet amour de la littérature d’aventure.
P.P. Je jette des petits cailloux que mon lecteur, adulte ou enfant, ramassera s’il le veut.
Votre écriture est très travaillée, incisive, caustique, dans la lignée de celle du fondateur du roman noir, Dashiell Hammet, mais avec une gouaille très française en référence à Léo Malet. Elle colle au polar…

P.P.Cette forme d’écriture vient de plus loin encore. Des pulps bien sûr, mais aussi d’écrivains comme le Mark Twain d’Huclkleberry Finn. Il y a dans ce roman de la distance, de la dérision, c’est un des premiers à faire entrer dans l’écrit cette langue parlée sur laquelle beaucoup d’auteurs ont travaillé. Côté français, je me reconnais bien sûr dans la petite musique dont vous parlez. J’aime y jeter des ponts entre l’univers adulte et celui de l’enfance. J’adorerai écrire un roman de pure aventure, mais pour le moment, je suis à nouveau embarqué dans l’écriture d’un roman noir pour adultes.
Propos receuillis par Claude André pour Citrouille.
Pour faire un tour chez les Sorcières, cliquer sur : Citrouille